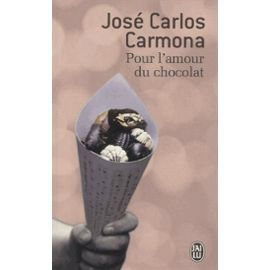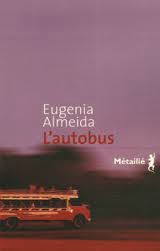LE CYCLISTE DE TCHERNOBYL ; Javier Sebastián
J’avais promis « ma rentrée » pour janvier ; alors, tant qu’à faire, je vais offrir, pour ma première chronique 2014, un roman qui – je ne l’ai compris qu’à la fin de ma lecture – provoque des débats assez houleux. C’est, d’ailleurs, un commentaire aussi anonyme qu’incorrect (et qui ne citait pas ses sources) sur le blog de Jérôme qui m’a assez peu délicatement mis la puce à l’oreille.
Autant le dire tout de suite, ce roman m’a bousculée. Un peu lente au démarrage, je me suis surprise à avaler les pages au fur et à mesure que l’intrigue se nouait et que ma compréhension des évènements s’opérait, et je faisais des allers/retours entre les chapitres et la 4ème de couverture. Parce que cette 4ème induit en erreur, si l’on n’y prend garde. « Ce roman magistral est librement inspiré de la vie de Vassilii Nesterenko, physicien spécialiste du nucléaire, devenu un homme à abattre pour le KGB pour avoir tenté de contrer la désinformation systématique autour de Tchernobyl ». Mes allers/retours, au fil de ma lecture, je les ai faits aussi avec la toile et la biographie de Vassilii Nesterenko. Et, pour équilibrer mes lectures et me donner la possibilité d’avoir un avis aussi objectif que possible (si ce l’est) sur cette tragédie mondiale, je lirai bientôt le document de Svetlana Aleksievich : « La supplication : Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse ». Parce que Vassilii Nesterenko, décédé en 2008, n’a jamais été ce « vieil homme hagard » abandonné sur les Champs Élysées qui n’a de crainte que d’être liquidé par le KGB. Vassia, le héros du roman magistralement écrit par Javier Sebastián, n’est pas Vassilii Nesterenko, même si comme son modèle et inspirateur, il est physicien nucléaire,
Ceci entendu, nous voici libres d’entrer dans un texte mené de main de maître, qui a obtenu le prix Cálamo 2011 en Espagne et a été traduit, outre en français chez Métailié par François Gaudry, en allemand, italien et néerlandais. C’est une fiction qui emprunte fidèlement au réel les lieux des évènements : la ville fantôme de Pripiat existe, avec sa grande roue et ses autos-tamponneuses en ruine, à trois kilomètres à peine de cette centrale du diable qui en un instant, en avril 1986, a compromis – voire détruit – irrémédiablement l’avenir de milliers de personnes. C’est le traitement créateur de cette catastrophe nucléaire et de ses conséquences qui a retenu mon attention et mon souffle tout au long des pages, l’alliance du contexte historique et documentaire avec une fiction très bien ficelée qui entraîne le lecteur dans une errance entre Paris, Minsk et Pripiat, au gré des exodes et des va-et-vient de la vie et de la mémoire du personnage central.
Javier Sebastián donne là un terrible réquisitoire contre le nucléaire, mais empreint d’une émouvante humanité pour ces survivants, ces « samosiol » qui veulent vivre là où la vie n’a plus de place.
Ils sont violents ces pans de vie qu’arrachent à la mort ces personnages fantasques qu’aucun tabou ne retient plus puisqu’ils sont conscients qu’ils vivent pour la dernière fois. Alors ils chantent Demis Roussos, alors ils jouent, alors ils s’entretuent, alors ils offrent leurs expériences à la science. Alors, les uns après les autres, ils meurent. Ils perdent à jamais leurs êtres chers et n’aspirent qu’à les rejoindre. Ils savent, mais ils poursuivent leur lutte – presqu’en silence – contre le silence. Celui du pouvoir en place qui tait sciemment ce cataclysme (et qui le taira au Monde avec a complicité des autres dirigeants planétaires) ; celui qui plombe Pripiat, « leur » ville qu’ils veulent jacasse ; celui qui m’a saisie lorsque j’ai refermé ce roman.